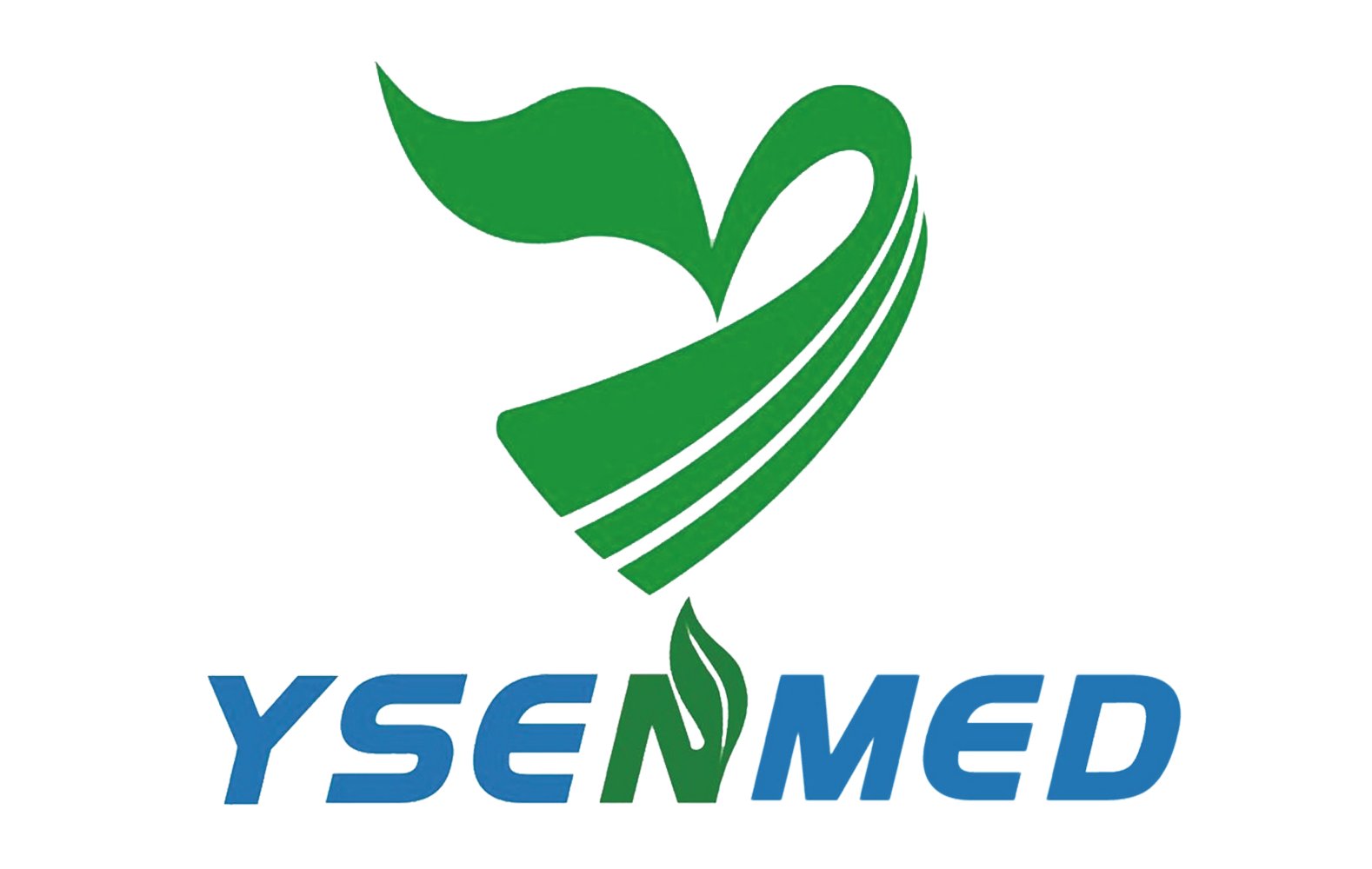Produits
Equipement vétérinaire
Appareil à rayons X vétérinaire
Échographe vétérinaire
Système d'endoscope vétérinaire
Equipement de laboratoire vétérinaire
Cages vétérinaires
Table d'opération vétérinaire
Anesthésie vétérinaire et ventilateur
Moniteur de patient vétérinaire
Équipement de toilettage vétérinaire
Tapis roulant vétérinaire
Système de réchauffement pour chirurgie vétérinaire
ECG vétérinaire
Balance vétérinaire
Table de perfusion vétérinaire
Pompe à perfusion et à seringue vétérinaire
Tableau d'anatomie vétérinaire
Instrument chirurgical vétérinaire
Table de traitement vétérinaire
Incubateur pour unité de soins intensifs vétérinaire
Générateur électrochirurgical vétérinaire
Lasers vétérinaires
Équipement dentaire vétérinaire
Chariot à instruments vétérinaires
Civière vétérinaire
Foret et scie vétérinaire
Unité de contention vétérinaire
Equipement ORL vétérinaire
Systèmes PCR vétérinaires
Hémodialyse vétérinaire
Matériel d'obstétrique et pour nourrissons
Incubateur pour bébé
Chauffe-bébé
Lit d'obstétrique et d'accouchement
Ventilateur nouveau - né CPAP
Vidéocolposcope
Appareil de traitement de la mastopathie
Bilirubinomètre pour nourrissons
Électrocoagulation gynécologique
Moniteur fœtal et maternel
Inspecteur des glandes mammaires
Unité de photothérapie pour nourrissons
Équipement de salle d'opération
Ventilateur médical
Ventilateur médical
Table d'opération
Lampe de fonctionnement
Unité électrochirurgicale
Moniteur de patient
Défibrillateur
Instrument chirurgical
Scalpel à ultrasons
Appareil d'électrocardiogramme
Machine à oxygène
Oxymètre
Pompe à perfusion
Pompe à seringue
Pendentif chirurgical
Dermatome électrique
Perceuse et scie électrique
Unité d'aspiration
Spiromètre
Machine de lavage gastrique
Garrot automatique
Appareil de thérapie à l'ozone
Détecteur de veines
EEG
Microscope opératoire
Equipement de laboratoire
Analyseur d'hématologie
Analyseur de biochimie
Analyseur de gaz sanguins / POCT
Analyseur d'immuno-essai
Analyseur d'urine
Analyseur d'électrolytes
Lecteur et laveur Elisa
Analyseur de coagulation
Analyseur de protéines
Centrifuger
Microscope
Incubateur
PCR
Analyseur de matières fécales
Électrophorèse
Équipement plasma
Analyseur d'hémoglobine
Analyseur ESR
Analyseur multi-gaz
Enceinte de biosécurité
Cytométrie de flux
Transilluminateur UV
Système d'imagerie sur gel
Analyseur de dioxyde de carbone
Bain sec
Analyseur d'acide urique
Analyseur de lipides sanguins
Analyseur de la fonction rénale
Spectrophotomètre
Machine de décongélation au plasma
Machine à eau pure de laboratoire
Analyseur d'humidité
Analyseur de la qualité de l'eau
Manteau chauffant
Évaporateur rotatif numérique
Détecteur d'Helicobacter Pylori
Chromatographie
Système de groupe sanguin
Titrateur
Balance analytique
Équipement dentaire
Appareil de radiographie dentaire
Chaises dentaires
Détartreurs à ultrasons
Capteur dentaire numérique
Cabinets dentaires
Machine de scellement dentaire
Unité d'aspiration dentaire
Nettoyeur dentaire à ultrasons
Scanner dentaire 3D
Consommables dentaires
Moteur d'implant dentaire
Chirurgie osseuse piézoélectrique
Équipement de stérilisation
Stérilisateur à vapeur sous vide
Stérilisateur à plasma à basse température
Stérilisateur à vapeur horizontal
Stérilisateur à vapeur vertical
Autoclaves de table (Classe B)
Laveurs Désinfecteurs Rapides
Stérilisateur à l'oxyde d'éthylène
Lampe à ultraviolets
Stérilisateur à vapeur portable
Stérilisateur à boulons
Instrument ORL
Unité de traitement ORL
OCTOBRE
Appareil de diagnostic ORL
Laryngoscope d'anesthésie
Lampe à fente
Microscopes chirurgicaux
Scanners ophtalmiques
Lampes frontales chirurgicales
Caméra Fudus
Réfractomètre
Tenonomètre
Périmètre automatique
Testeur de dépistage de la vue
Phoroptère
Topographe cornéen
Appareil de mesure de la lentille
Chauffage de cadre
Testeur de verres photochromiques
Machine à poinçonner les lentilles
Appareil de mesure de l'épaisseur de la lentille
Rainureuse de lentilles
Polisseuse de lentilles
Extracteur de vis
Yeux simulés
Foreuse à trois trous
Cadre d'essai
Tableau de vision à LED
Projecteur de diagrammes de vision
Mesureur de distance entre élèves
Outils de montage de lunettes
Nettoyeur à ultrasons pour lunettes
Ensemble de lentilles d'essai
Moniteur de graphique LCD
Compteur de stress
Bloqueur de mise en page
Coupe-bordures de lentilles
Audiomètre
Analyseur de sécheresse oculaire
Prothèse auditive